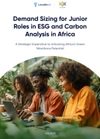Favoriser les moyens de subsistance durables et la création d'emplois
L'agriculture est au cœur des économies de la Côte d'Ivoire et du Bénin, fournissant des moyens de subsistance à la majorité de la population et soutenant la sécurité alimentaire nationale. Pourtant, des lacunes persistent dans les systèmes de soutien formels, et les jeunes et les femmes continuent de se heurter à des obstacles pour accéder à la terre, au financement, aux services de vulgarisation et à la direction des coopératives. Ces obstacles excluent de nombreuses personnes des possibilités d'amélioration de la productivité ou de leurs moyens de subsistance.
Dans ce contexte, les pratiques numériques remodèlent la façon dont l'agriculture, la transformation et le commerce se déroulent. L'agriculture sociale, c'est-à-dire l'utilisation des médias sociaux pour échanger des informations, accéder aux marchés et créer des communautés, est devenue un élément déterminant de cette transformation. Les groupes WhatsApp sont devenus des canaux essentiels de coordination et de conseil. Les pages Facebook servent désormais de vitrines, permettant une visibilité bien au-delà des marchés locaux. TikTok et Instagram font connaître les produits locaux et les nouvelles techniques agricoles à un public plus large, les jeunes étant souvent au cœur de la narration numérique. Pour de nombreux agripreneurs, ces plateformes sont plus que des outils de communication : elles sont le prolongement de systèmes de conseil, de marchés et de communautés.
Ce rapport s'appuie sur les études antérieures de Caribou sur l'agriculture sociale au Kenya, au Nigéria, au Ghana et au Sénégal, et étend l'analyse à la Côte d'Ivoire et au Bénin. S'appuyant sur des entretiens, des groupes de discussion et des recherches documentaires régionales, il examine la manière dont les jeunes et les femmes saisissent les opportunités numériques, les obstacles qu'ils rencontrent et les conditions de l'écosystème qui façonnent leur participation. Il met en lumière l'ingéniosité avec laquelle les agripreneurs adaptent les outils mobiles à leurs réalités, les réseaux informels qui comblent les lacunes des systèmes formels et les nouveaux types de travail qui émergent au fur et à mesure de l'évolution des pratiques numériques.
Perspectives
- Adoption: L'agriculture sociale modifie l'engagement des jeunes dans l'agriculture, mais les obstacles liés à l'écosystème en limitent la portée. Les jeunes utilisent WhatsApp, Facebook et TikTok pour promouvoir des produits, échanger des connaissances et entrer en contact avec des acheteurs. La pénétration des smartphones, le coût élevé des données et les contraintes liées au genre signifient que l'adoption reste inégale, en particulier dans les zones rurales.
- Compétences: Les compétences numériques se développent grâce à l'apprentissage par les pairs, mais les écosystèmes de formation restent inégaux. Les agripreneurs acquièrent des compétences pratiques - prendre des photos de produits, gérer les ventes en ligne ou expérimenter les paiements mobiles - souvent par le biais d'essais et d'erreurs ou d'un accompagnement par les pairs. La formation formelle reste largement urbaine et suppose un niveau de confiance numérique que beaucoup de femmes et de jeunes ruraux n'ont pas encore.
- L'écosystème: Les structures de soutien formelles s'adaptent lentement, les lacunes étant comblées par les réseaux informels. Les services de vulgarisation traditionnels, les coopératives et les institutions nationales de formation peinent à suivre le rythme du changement numérique. En leur absence, les agripreneurs ont créé des communautés en ligne et des groupes de pairs qui jouent désormais un rôle essentiel dans l'échange de connaissances, l'instauration d'un climat de confiance et même la mise en commun des ressources.
- Monétisation: Les voies financières s'élargissent, mais les exclusions de l'écosystème limitent l'utilisation des plateformes. Les agripreneurs utilisent l'argent mobile, le crowdfunding et les réseaux de confiance communautaires pour mobiliser des fonds. Les obstacles à la monétisation formelle des plateformes en Afrique de l'Ouest francophone, combinés à une faible intégration entre les médias sociaux et les systèmes financiers, limitent une participation plus large.
- La confiance: La crédibilité et la gestion des risques sont essentielles, façonnées par les normes sociales et une infrastructure numérique fragile. Les médias sociaux ouvrent de nouveaux marchés, mais la fraude, la désinformation et le harcèlement restent des risques majeurs. Les agripreneurs gèrent ces défis grâce à la transparence, à la réputation et à la surveillance collective, montrant ainsi que la confiance continue d'être à la base des échanges numériques.
- IA: les outils émergents ouvrent des possibilités, mais l'état de préparation de l'écosystème reste limité. Les agripreneurs urbains commencent à tester l'IA pour l'image de marque, le marketing et l'interaction avec les clients. Si ces outils laissent entrevoir de futures opportunités, ils restent souvent mal adaptés aux réalités des économies informelles et mobiles.
Implications en termes de politiques et de programmes
- Les gouvernements et les décideurs politiques devraient reconnaître officiellement les agripreneurs sociaux dans les stratégies agricoles et d'économie numérique, développer des systèmes d'identité et financiers adaptés aux mobiles et renforcer la protection des consommateurs sur les marchés numériques.
- Les ONG, les instituts de formation et les partenaires de développement devraient développer des modèles de formation et de mentorat menés par des pairs, veiller à ce que les femmes et les jeunes ruraux soient inclus dans les tests d'utilisation et la conception des outils, et investir dans des programmes accessibles de sécurité numérique et d'alphabétisation financière.
- Les institutions de recherche devraient approfondir les preuves de l'impact économique de l'agriculture sociale, tester des approches innovantes telles que le financement communautaire et le conseil basé sur l'IA, et s'assurer que les idées sont rendues accessibles aux praticiens et aux décideurs politiques.
- Les groupes d'agriculteurs et les coopératives devraient renforcer leur présence numérique collective, mettre en commun leurs ressources pour une visibilité partagée et officialiser les rôles de formation par les pairs qui comblent déjà les lacunes en matière de vulgarisation.
- Les acteurs du secteur privé, y compris les plateformes et les entreprises d'agritech, devraient adapter leurs produits aux réalités des économies numériques informelles, réduire les obstacles à la monétisation des plateformes et développer des partenariats avec les formateurs locaux et les groupes d'agriculteurs.
Appel à l'action
En reliant l'innovation numérique aux expériences vécues par les jeunes agripreneurs - en particulier les femmes et les communautés rurales - l'agriculture sociale peut devenir un puissant moteur de l'emploi inclusif, de la résilience du système alimentaire et de la participation numérique dans l'ensemble de l'UEMOA. Des investissements coordonnés, une reconnaissance et un soutien politique sont désormais essentiels pour garantir la réalisation de ce potentiel.